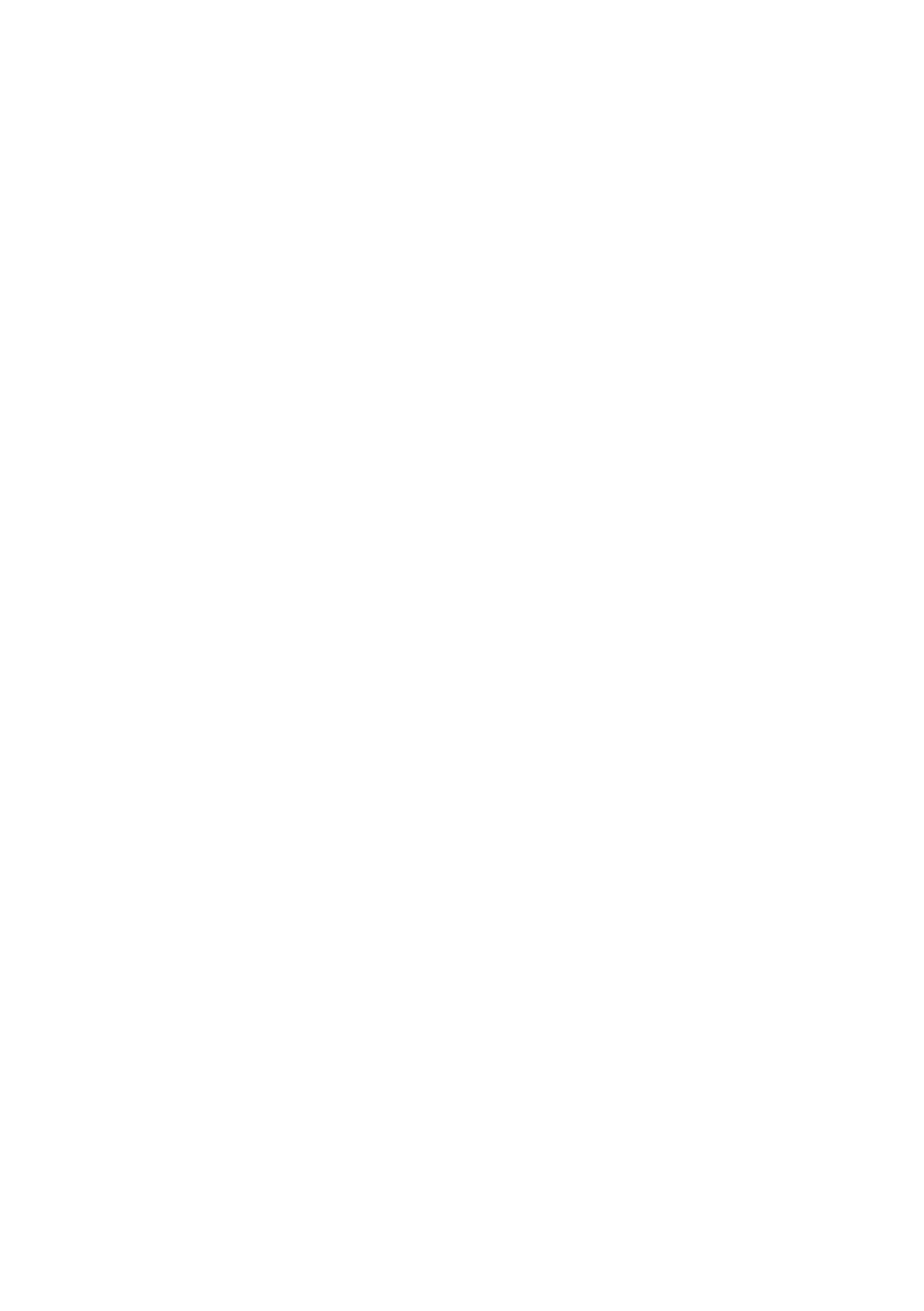Lettre d’Information franco-allemande | Décembre 2020
Par le biais de cette Lettre d’information bilingue, nous souhaitons vous tenir informés de l’actualité juridique et fiscale allemande et française. Cette Lettre est rédigée par l’Équipe franco-allemande de GGV qui a pour vocation de conseiller les entreprises françaises et venant de pays francophones sur le marché allemand, et les entreprises allemandes et de pays germanophones sur le marché français.
Actualités France
- DROIT FISCAL – En cas de montage artificiel constitutif d’un abus de droit, impossible de se prévaloir d’un commentaire administratif favorable !
- DROIT COMMERCIAL - L’organisation d’un rappel de produits ne suffit pas à prouver l’existence d’un vice caché
- DROIT COMMERCIAL - Nouvelles perspectives pour l'industrie du cannabis en France
- DROIT DU TRAVAIL- Quelques nouveautés concernant les mesures intéressant les entreprises en période de Covid-19
- DROIT DE LA PROTECTION DES DONNEES – la CJUE invalide le « Privacy Shield »
- COMPLIANCE - Licenciement pour faute grave d’un salarié ayant accepté des cadeaux d’un fournisseur
- DROIT IMMOBILIER - Le locataire ne peut plus renoncer au statut des baux commerciaux au-delà de trois ans
- CORPORATE - Associés minoritaires lésés : quels recours ?
Actualités France
DROIT FISCAL – En cas de montage artificiel constitutif d’un abus de droit, impossible de se prévaloir d’un commentaire administratif favorable !
Suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 20.12.2018 commenté dans la LFA d’août 2019 (CAA Paris, 20.12.2018, n°17PA00747).
Dans une décision rendue le 28.10.2020 (n°428048), le Conseil d’État a jugé que l’administration fiscale pouvait mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit à l’encontre d’un contribuable qui avait appliqué littéralement une instruction administrative en mettant en place un montage artificiel élaboré sans autre finalité que d’éluder l’impôt.
Le litige concerne le bénéfice par des dirigeants de PME partant à la retraite d’un régime favorable de cessions de titres de société (abattement sur la plus-value de cession qu’ils réalisent) qui est soumis à la condition qu’ils ne détiennent aucun droit de vote, ni droit financier dans la société cessionnaire pendant un certain délai. Par dérogation à la loi fiscale, une instruction de 2007 prévoyait que le cédant pouvait détenir une participation maximum de 1% dans la société cessionnaire.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, l’administration a remis en cause le bénéfice de ce régime favorable sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit. Elle a fait valoir qu’en cédant une partie des actions que le contribuable détenait dans la société cessionnaire, la veille de la cession de la société qu’il dirigeait, il avait volontairement ramené sa participation à moins de 1% dans celle-ci dans le seul but de se placer dans les prévisions de l’instruction de 2007. La CAA de Paris confirme la position de l’administration en jugeant que l’application littérale d’une instruction pouvait être constitutive d’un abus de droit par fraude à la loi.
Il se posait donc la question pour le Conseil d’État de savoir si l’administration peut mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit à l’encontre d’un contribuable qui applique littéralement une instruction administrative.
Le Conseil d’État confirme tout d’abord une jurisprudence bien établie en rappelant qu’un contribuable peut se prévaloir d’une instruction ou d’une circulaire qui lui serait plus favorable, même lorsqu’elle ajoute à la loi ou la contredit, à condition d’en respecter les termes. Concrètement, l’administration ne peut pas rehausser l’imposition du contribuable en soutenant que, tout en se conformant aux termes d’une instruction ou d’une circulaire, il aurait outrepassé la portée que l’administration entendait en réalité conférer à ce texte.
Le Conseil d’État ajoute cependant que cette garantie ne peut pas être invoquée lorsque l’administration, tout en respectant les garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit, démontre par des éléments objectifs que le contribuable a mis en place un montage artificiel élaboré sans autre finalité que d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
Par cette décision, le Conseil d’État restreint la possibilité pour le contribuable d’invoquer une instruction ou une circulaire favorable, sous réserve que l’administration apporte la preuve d’une part, du caractère artificiel du montage et d’autre part, de ce qu’il n’a eu pour seul objet d’éluder le paiement de l’impôt.
DROIT COMMERCIAL - L’organisation d’un rappel de produits ne suffit pas à prouver l’existence d’un vice caché
Pour l’association de consommateurs CLCV, l’organisation d’une campagne de rappel par un fabricant de motos suffisait à démontrer l’existence de vices cachés affectant un de ses modèles. Ces prétentions sont rejetées par le tribunal judiciaire de Versailles dans une décision du 4 juin 2020.
Dans l’affaire en cause, l’association CLCV tentait d’obtenir la réparation des préjudices économiques individuels subis par un groupe de consommateurs, acheteurs d’un modèle de moto ayant fait l’objet d’une campagne de rappel. Le préjudice allégué était lié notamment au temps d’immobilisation du véhicule.
L’argumentation de l’association CLCV était fondée sur l’existence d’un vice caché, que le fabricant aurait reconnue par ses courriers annonçant le rappel. Le tribunal judiciaire de Versailles considère que le fabricant ne faisait que respecter son obligation en matière de sécurité de produit inscrite au code de la consommation, dans le cadre d’une action préventive. CLCV n’a notamment pas fourni d’explications techniques sur la nature de la défectuosité alléguée, et il n’y a eu aucun accident en lien avec cette dernière.
Il n’est pas exclu que CLCV aurait pu obtenir réparation des préjudices liés à l’immobilisation des motos sur un autre fondement que les vices cachés. Toutefois, cette décision, de première instance, reste rassurante pour les fabricants dans le sens où elle les conforte dans le fait que, en l’absence d’autres éléments, l’organisation d’une campagne de rappel ne vaut pas reconnaissance de l’existence d’un vice caché.
Ainsi, il vaut mieux organiser une campagne de rappel avant tout incident plutôt que de devoir subir les conséquences potentiellement plus lourdes de la qualification de vice caché, notamment le droit de l’acheteur de demander l’annulation de la vente.
DROIT COMMERCIAL - Nouvelles perspectives pour l'industrie du cannabis en France
1. CDB : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qualifie d’illégale l’interdiction du commerce avec le cannabidiol (CDB) par la France
Parmi les pays de l’Union Européenne, l’Allemagne est le pionnier de l’industrie du cannabis : dans aucun autre État membre, autant de jeunes entreprises se concentrent sur ce nouveau secteur potentiellement très lucratif. Selon EY, rien qu’en 2019, 37 millions euro d’investissement ont été versés à de nouvelles entreprises allemandes pour la production et la distribution de produits de consommation à base de CBD, tels que des crèmes, des huiles à inhaler et à fumer, ainsi que des médicaments à base de cannabis.
Les derniers développements en France devraient donner aux entreprises allemandes une raison de se réjouir : dans son arrêt du 19.11.2020 dans l’affaire C-663/18 (Kanavape), la plus haute juridiction de l’UE classe désormais l’interdiction française du commerce des produits de la CBD comme illégale au regard du droit européen.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait demandé à la CJUE de se prononcer sur la question de la compatibilité avec le droit communautaire de l’article 1 du Décret du 22.08.1990 qui limite la culture, l’importation et l’utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante. L’affaire portée devant la Cour d’Aix concerne l’importation et la commercialisation du liquide électronique pour cigarettes électroniques contenant de l’huile de cannabidiol (CBD), qui est obtenue à partir de la plante de chanvre entière, et pas seulement des fibres et des graines. Comme le THC, le CBD est une molécule dérivée de la plante de chanvre. Contrairement au THC, cependant, il n’a pas été démontré que le CBD a les mêmes propriétés anesthésiques que le THC.
Dans son arrêt du 19.11.2020, la Cour européenne de justice s’est prononcée pour la première fois sur la légalité de la distribution de CBD dans l’UE en général, et en France en particulier. L’arrêt fournit une interprétation contraignante du droit communautaire pour les États membres et les institutions de l’UE et indique maintenant la voie à suivre pour l’industrie encore jeune du CBD en Europe, dont le développement a été jusqu’à présent considérablement entravé par les réglementations opaques et hétérogènes des États membres.
Selon la CJUE, la CBD ne doit pas être classée comme un stupéfiant selon l’état actuel de la science et sur la base des accords internationaux applicables, de sorte que les dispositions de l’UE sur la libre circulation des marchandises entre les États membres s’appliquent également au CBD : une interdiction générale du commerce des produits du CBD dans un État membre serait donc en contradiction avec le droit communautaire applicable.
Néanmoins, la CJUE a également souligné qu’une telle interdiction pouvait très bien être justifiée en vertu du principe de précaution pour protéger la santé publique, à condition que l’interdiction ne soit absolument nécessaire et proportionnée. Toutefois, la CJUE a noté que l’interdiction actuelle du CBD par la France ne passera probablement pas le test de nécessité et de proportionnalité, car la législation française n’interdit jusqu’à présent « que » le CBD naturel mais autorise le CBD synthétique, qui est chimiquement très similaires aux substances naturelles.
Il faut s’attendre à ce que, dans un avenir proche, une réglementation plus proportionnée des produits à base de CBD, fondée sur un risque réel pour la santé, soit introduite en France. Pour les entrepreneurs allemands et français dans le domaine du CBD, cela signifie probablement qu’un tout nouveau marché s’ouvrira à eux ce qui leur demandera également de naviguer sur les nouvelles réglementations françaises à venir, par exemple en ce qui concerne les conditions pour la commercialisation.
En fait, les autorités françaises ont déjà exprimé leur avis sur cette question le 24.11.2020, lorsque la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (« MILDECA ») a pris note de l’arrêt dans un communiqué officiel. La déclaration souligne que la loi actuelle, c’est-à-dire l’interdiction du CBD, restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, la MILDECA a clairement indiqué que le développement d’une approche européenne commune des produits à base de CBD serait souhaitable. À cet égard, ils poursuivent leurs échanges avec les autres États membres et la Commission européenne, mais il est prévu que le marché français s’ouvre aux produits à base de CBD dans un avenir proche.
2. Le statut du cannabis médical en France
Alors que dans 22 pays de l’UE, et depuis janvier 2017 également en Allemagne, le cannabis médical est déjà disponible sur ordonnance pour les patients gravement malades, la France a jusqu’à présent eu des difficultés à se faire à l’idée d’une éventuelle légalisation.
En France, le cannabis est considéré comme un stupéfiant dont la possession et l’usage sont interdits (Loi n° 70-1320 du 31.12.1970). L’interdiction stricte a reçu un premier « assouplissement » en 2013, par le Décret n° 2013-473, modifiant les dispositions de l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique relatives à l’interdiction des transactions sur le cannabis ou ses dérivés. Depuis, deux médicaments à base de cannabis ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché en France, mais ils ne sont pratiquement pas commercialisés : le SATIVEX (pour traiter la spasticité modérée à sévère associée à la sclérose en plaques comme traitement de deuxième intention chez les patients adultes) et le MARINOL (substance synthétique à base de cannabis, pour traiter la douleur neuropathique après échec de tous les traitements, nausées et vomissements pendant la chimiothérapie anticancéreuse et anorexie chez les patients séropositifs).
En 2021, le marché des préparations médicales à base de cannabis devrait s’ouvrir davantage : suite aux recommandations de l’ANSM (Agence nationale de sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé) du 11.07.2019, le gouvernement a publié le 7.10.2020 le Décret n° 2020-1230 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis donnant feu vert pour un programme pilote pour prescription du cannabis médical. Ce décret a été complété par le Décret du 16.10.2020, fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l’expérience.
Le programme pilote sur le cannabis est destiné à durer deux ans à partir de la première prescription d’un tel médicament et à donner un accès gratuit aux drogues de cannabis à environ 3000 patients souffrant de pathologies particulièrement graves. La première ordonnance doit être prescrite au plus tard à la fin du mois de mars 2021. Les médicaments ne peuvent être prescrits que pour les indications limitées et particulièrement graves suivantes : douleurs neuropathiques réfractaires au traitement (médicamenteuses ou non) ; certaines formes d’épilepsie pharmacorésistantes ; certains symptômes rebelles en oncologie associés au cancer ou à son traitement ; situations palliatives (fin de vie) ; spasticité douloureuse (contraction exagérée des muscles réflexes) dans la sclérose en plaques ou autres troubles du système nerveux central.[1]
Les médicaments à base de cannabis peuvent être prescrits sous forme de fleurs sèches, d’huile ou de capsules. [2] Les fabricants de cannabis médicinal avaient jusqu’au 24/11/2020 pour demander à devenir un fournisseur officiel de ce programme pilote.
Si le programme pilote est couronné de succès, cette étape pourrait être clé pour l’ouverture future du marché français.
[1] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14362
[2] https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Cannabis-a-usage-medical/Cadre-de-l-experimentation-du-cannabis-a-usage-medical/(offset)/2
DROIT DU TRAVAIL- Quelques nouveautés concernant les mesures intéressant les entreprises en période de Covid-19
Sont ci-après brièvement abordés le protocole sanitaire en entreprise, le télétravail, ainsi que l’activité partielle.
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, a été actualisé le 13.11.2020. Il comporte, comme dans ses précédentes versions, des précisions sur les règles que l’employeur doit fixer, dans le cadre d’un dialogue social avec les représentants du personnel, et faire respecter par les salariés pour prévenir les risques pour leur santé. Les principales nouveautés concernent l’organisation des réunions, ainsi que le télétravail.
Le protocole national précise désormais que les réunions en audio ou visioconférence doivent désormais être la règle et les réunions en présentiel rester exceptionnelles.
Concernant le télétravail, le protocole national prévoit que « le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Le temps effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail, de lisser les horaires de départ et d’arrivée du salarié pour limiter l’affluence aux heures de pointe, et d’aménager le temps de présence en entreprise afin de réduire les interactions sociales. »
Dans ses questions-réponses concernant le télétravail du 17.11.2020, le ministère du travail préconise par ailleurs le recours au télétravail partiel pour les salariés qui peuvent accomplir une partie de leurs tâches à distance. Il a également rappelé que la mise en place du télétravail dans la situation actuelle constitue un simple aménagement du poste de travail du salarié, qui peut lui être imposé, conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail.
En l’absence d’un accord d’entreprise ou une charte relative au télétravail fixant les critères d’éligibilité au télétravail, il convient donc que l’employeur identifie les postes et les activités pouvant faire l’objet de télétravail, total ou partiel, et ce, en concertation avec les représentants du personnel et des salariés concernés.
Depuis mars 2020, le gouvernement a largement aménagé, à titre exceptionnel et dérogatoire, le dispositif d’activité partielle. Les dispositions qu’il a pris à cet effet devront prendre fin le 31.12.2020.
Toutefois, la loi du 14.11.2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire a habilité le Gouvernement à prendre, jusqu’au 16.02.2021, un certain nombre de mesures par ordonnances, notamment en matière d’activité partielle. Le Gouvernement pourra ainsi proroger les dispositions exceptionnelles relatives à l’activité partielle, qui sont actuellement en vigueur, jusqu’au 16 février prochain.
A défaut, le taux de l’allocation horaire d’activité partielle dont bénéficie l’employeur baissera, comme il est actuellement prévu par le Décret n° 2020-1319 du 30.10.2020, à compter du 01.01.2021 de 70% à 36%. Le taux de l’indemnité horaire des salariés placés en activité partielle restera toutefois fixé à 70 % de la rémunération horaire brute de référence.
Rappelons enfin que l’employeur peut également avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), qui peut notamment être mis en place par un accord d’entreprise ou par un document unilatéral de l’employeur, intervenu en application d’un accord de branche étendu. Ce dispositif s’applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 30.06.2022.
DROIT DE LA PROTECTION DES DONNEES – la CJUE invalide le « Privacy Shield »
Par un jugement du 16.07.2020 (aff. C-311/18 « Schrems II ») la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé la décision d’adéquation (« Privacy Shield ») adoptée par la Commission européenne concernant les États-Unis et qui permettait jusque-là à de nombreux acteurs économiques de transférer des données à caractère personnel de l’Espace économique européen vers les États-Unis.
A titre préalable, il faut ici rappeler qu’un responsable de traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à l’Union européenne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Un tel niveau suffisant de protection sera présumé exister, lorsque la Commission européenne aura constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat.
La Commission européenne a adopté plusieurs décisions d’adéquation, constatant notamment que la Suisse, l’Argentine, Guernesey, l’Ile de Man, la Nouvelle-Zélande, Jersey, les îles Féroé, Andorre, Israël, l’Uruguay, le Canada et le Japon assurent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
En ce qui concerne les États-Unis, la Commission européenne a, en 2016 adopté une décision d’adéquation qui prévoyait la possibilité pour les entreprises américaines, importatrices de données en provenance d’Europe, de se soumettre volontairement à des règles contraignantes édictées dans un programme de conformité dénommé « Privacy Shield » qui a été élaboré d’un commun accord par la Commission européenne et l’administration américaine
A défaut d’une telle décision d’adéquation, des données à caractère personnel ne peuvent être transférées en dehors de l’Union européenne que si le responsable de traitement ou son sous-traitant ont prévu des garanties appropriées. Ces garanties peuvent être fournies à travers, en particulier, les instruments suivants :
- les règles d’entreprises contraignantes (Binding Corporate Rules ou BCR) (qui désignent une politique de protection des données applicable au sein d’un groupe de sociétés) ,
- les clauses contractuelles type de protection adoptées par la Commission européenne ou par une autorité de contrôle et approuvées par la Commission,
- par un code de conduite approuvé ou encore un mécanisme de certification approuvé.
Cela précisé, la décision commentée a été rendue dans le contexte de la plainte déposée par l’avocat autrichien Max Schrems devant l’autorité de contrôle irlandaise contre le transfert, par Facebook Irlande, de données à caractère personnel à destination des États-Unis. Dans sa plainte, Max Schrems critiquait en particulier le fait que les États-Unis ne sont pas en mesure d’offrir aux données à caractère personnel stockées sur leur territoire un niveau de protection suffisant contre les activités inquisitives de l’administration américaine.
Saisie d’une première question préjudicielle, le CJUE avait dès 2015 invalidé l’accord « Safe Harbor » de la Commission européenne (cf. Aff. CJUE C-362/14 – « Schrems I »).
La décision d’adéquation « Privacy Shield » qui a été adoptée par la Commission européenne suite à cette invalidation de l’accord « Safe Harbor », a été soumise à l’appréciation de la CJUE dans le cadre d’une nouvelle question préjudicielle et a également été invalidée par la Haute juridiction (cf. Aff. CJUE C-311/18 « Schrems II »).
Dans son arrêt rendu le 16 juillet 2020, la CJUE a en effet jugé que la décision d’adéquation « Privacy Shield » n’est pas une base légale valide pour le transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis puisqu’elle n’est pas de nature à garantir un niveau de protection suffisant aux personnes concernées. Pour en arriver là, la CJUE a notamment relevé que la règlementation interne des États-Unis permet aux autorités publiques américaines d’accéder et d’utiliser les données transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis, rendant ainsi possibles les ingérences dans les droits fondamentaux des personnes dont les données sont transférées vers les États-Unis, sans pour autant que ces ingérences ne soient encadrées ou que les personnes concernées ne disposent d’un droit effectif de recours contre ces ingérences, dans des conditions offrant des garanties substantiellement équivalentes à celles offertes au sein de l’Union européenne.
La conséquence pratique de cette décision est que les entreprises ne peuvent plus se fonder sur le « Privacy Shield » pour opérer des transferts de données vers les États-Unis. Une solution de substitution pourrait consister, pour les entreprises, à conclure entre elles des « clauses contractuelles types » permettant, en principe, d’assurer un niveau de protection suffisant.
Or, dans son arrêt, la CJUE a jugé que ces clauses contractuelles type restent certes valides, mais en tant que telles, ne sont pas non plus suffisantes pour assurer le niveau de protection suffisant exigé par la règlementation européenne. En effet, la CJUE a jugé qu’« il est inhérent au caractère contractuel des clauses types de protection des données que celles-ci ne sauraient lier les autorités publiques des pays tiers », de sorte qu’« il peut s’avérer nécessaire de compléter les garanties que contiennent ces clauses types de protection des données. »
Il en découle qu’il appartient désormais au « responsable du traitement ou à son sous-traitant de vérifier, au cas par cas et, le cas échéant, en collaboration avec le destinataire du transfert, si le droit du pays tiers de destination assure une protection appropriée, au regard du droit de l’Union, des données à caractère personnel transférées sur le fondement de clauses types de protection des données, en fournissant, au besoin, des garanties supplémentaires à celles offertes par ces clauses. »
Dans ses récentes recommandations, ouvertes à consultation publique jusqu’à mi-décembre 2020, le Comité Européen pour la Protection des Données propose un guide pratique visant à assister les responsables de traitement et sous-traitants dans leur audit des garanties offertes par le pays tiers et de l’évaluation des garanties supplémentaires nécessaires en vue d’atteindre un niveau de protection suffisant
Dans le même ordre d’idées, la Commission européenne vient de publier une version révisée de ses clauses contractuelles type, également ouvertes à consultation jusqu’au 10 décembre.
A côté des clauses contractuelles types complétées, au cas par cas et si nécessaires par des garanties supplémentaires, le RGPD offre d’autres mécanismes de transfert de données vers des pays tiers. Parmi ceux-ci figurent les « Binding corporate Rules » (BCR), ainsi que, dans certains cas, le consentement exprès de la personne concernée. En ce qui concerne les BCR, il convient de noter qu’il s’agit de règles contraignantes relatives à la protection des données, applicables entre différentes sociétés appartenant à un groupe de sociétés (voir à cet égard article 46, al.2, b) du RGPD). De manière similaire aux clauses contractuelles types, le caractère contractuel inhérent aux BCR, ces dernières ne sauraient lier les autorités publiques des États tiers. Il en découle qu’en cas de recours aux BCR, il convient au préalable d’examiner si un niveau de protection adéquat existe au sein de L’État tiers destinataire des données.
De même, si le transfert de données vers un État tiers à l’Union européenne est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement devra, avant de recueillir ce consentement, informer la personne concernée des risques que ce transfert peut comporter pour elle en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées. Ainsi, en pratique le transfert de données vers des États tiers ne pourra que très rarement être réalisé sur cette base, dans la mesure où un examen du niveau de protection s’avérera en réalité incontournable.
GGV recommande : passer en revue les relations contractuelles avec vos fournisseurs et cocontractants, tout en vérifiant si des transferts de données vers des pays tiers / les États-Unis y sont prévus. Si tel est le cas, il conviendra de vérifier, si le pays tiers concerné dispose d’un niveau de protection adapté et d’adapter en conséquence les instruments sur lesquels le transfert vers le pays tiers est fondé.
COMPLIANCE - Licenciement pour faute grave d’un salarié ayant accepté des cadeaux d’un fournisseur
La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 29.05.2020 (n°18/00395), a considéré que les cadeaux d’un fournisseur, acceptés en violation des règles internes de l’entreprise par un salarié peut justifier son licenciement pour faute grave.
En l’espèce, une salariée qui occupait les fonctions d’assistante achats a violé la politique éthique en vigueur au sein de la société, plus précisément le code de conduite et la politique cadeaux. Malgré sa connaissance avérée de la politique éthique, elle a accepté en cadeaux d’un fournisseur, de recevoir deux tablettes iPad mini. Au lieu de les faire livrer au siège de la société, elle a expressément demandé à ce que les deux tablettes soient livrées à son domicile.
Alerté, l’employeur a mené une enquête interne en coopération avec le fournisseur concerné, qui a confirmé les faits allégués et l’intervention d’un salarié du fournisseur a permis d’empêcher la livraison des cadeaux en question au domicile de la salariée.
En dépit de l’absence de livraison effective, l’employeur a licencié pour faute grave la salariée, considérant que les manquements de la salariée étaient totalement inacceptables en ce qu’ils contrevenaient aux règles internes en vigueur au sein de la Société et du Groupe (code de conduite professionnelle, politique de conduite en affaires, politique en matière de cadeaux et marques de courtoisie, politique relative aux lois anti-corruption), ce dont la salariée avait pleinement conscience.
La cour d’appel a jugé que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, car la violation des règles déontologiques en vigueur chez l’employeur constituant un manquement de la salariée à son obligation de loyauté.
Cette décision de la Cour d’appel d’Angers montre que l’employeur doit veiller à rendre opposable et porter à la connaissance de ses salariés les règles qu’il met en place au sein de l’entreprise, s’il veut pouvoir les opposer aux salariés et éventuellement, prononcer à leur encontre une sanction disciplinaire.
DROIT IMMOBILIER - Le locataire ne peut plus renoncer au statut des baux commerciaux au-delà de trois ans
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que les parties à un bail de courte durée ne peuvent déroger au statut des baux commerciaux au-delà de trois ans pour exploiter un même fonds de commerce dans un même local.
La Cour de cassation estimait jusqu’à présent que le locataire pouvait renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, statut protecteur de ses intérêts, même lorsque la durée cumulée des baux dérogatoires dépassait la durée légale maximale de deux ans. Les parties pouvaient ainsi conclure des baux dérogatoires à l’infini, tant que le locataire renonçait au statut des baux commerciaux.
Depuis la loi du 18.06.2014 dite « loi Pinel » les parties peuvent conclure des baux dérogatoires au statut des baux commerciaux dans la limite d’une durée cumulée de trois ans. La loi Pinel ajoute qu’à l’issue de ces trois ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Se pose alors la question de savoir si le locataire peut, malgré cette nouvelle disposition, toujours renoncer au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, un bailleur et un locataire avaient successivement signé deux baux de courte durée, le deuxième contrat de bail arrivant à terme le 31.05.2015, soit après l’entrée en vigueur de la loi Pinel. Au terme du deuxième bail, les parties avaient conclu un nouveau bail de courte durée d’un an. Ce nouveau bail stipulait de manière expresse que le locataire renonçait au statut des baux commerciaux. A l’issue de ce troisième bail, le bailleur informait le locataire ne pas vouloir le renouveler. Le locataire a alors revendiqué le droit au statut des baux commerciaux. Le bailleur l’a assigné en expulsion.
La cour d’appel a fait droit à la demande du bailleur. Le locataire s’est pourvu en cassation en faisant valoir qu’il avait acquis son droit la propriété commerciale à la fin du bail dérogatoire puisqu’il justifie d’une entrée dans les locaux depuis au moins trois ans conformément à l’article L. 145-5 C. com.
Par arrêt du 22.10.2020, la Cour de cassation a donné raison au locataire en jugeant que le troisième contrat de bail était soumis à l’article L. 145-5 C. com. dans sa version issue de la loi Pinel. Les parties ne peuvent plus conclure un bail dérogatoire dérogeant au statut des baux commerciaux au-delà de la durée de trois ans.
Au-delà de trois ans de bail dérogatoire, les parties sont donc soumis au statut des baux commerciaux. Passé ce délai, toute renonciation par les parties au statut est inopérante.
GGV vous conseille : le statut des baux commerciaux fixe la durée minimale du bail à neuf ans. Les parties souhaitant éviter cette durée devront prêter une attention particulière aux clauses permettant d’écourter le bail comme par exemple les conditions d’application de la clause résolutoire ou bien négocier des garanties financières plus conséquentes.
CORPORATE - Associés minoritaires lésés : quels recours ?
L’enjeu même du contrat de société étant la distribution de bénéfices, un actionnaire minoritaire qui ne percevrait aucun dividende, ou qui verrait sa participation au capital complètement diluée pourrait être tenté d’obtenir en justice réparation de son préjudice.
Cependant, l’Assemblée Générale, par le truchement de l’adoption des délibérations à la majorité des voix, est supposée exprimer les intérêts de la collectivité.
La souveraineté de ses délibérations régulièrement votées sera donc difficilement contestable.
La loi et la jurisprudence reconnaissent cependant aux actionnaires minoritaires qui ne seraient pas convaincus du bien-fondé de la décision prise à la majorité, des moyens de demander en justice l’annulation des délibérations ainsi adoptées.
Le moyen de ce contrôle leur est fourni par l’action en abus de majorité et, de façon moins fréquente, par l’action en fraude de leurs droits.
Abus de majorité
Par une jurisprudence constante, la Cour de Cassation a établi les deux critères permettant de caractériser l’abus de majorité : l’absence de conformité de la décision à l’Intérêt social et l’intention de défavoriser l’actionnaire minoritaire au profit du ou des actionnaires majoritaires.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2020 vient ainsi rappeler que, malgré une augmentation corrélative des salaires des associés-gérants-majoritaires, la mise en réserve systématique des dividendes, par le fait même qu’elle participait à une bonne et prudente gestion de la Société permettant de fait d’assurer à cette dernière une capacité de remboursement sûre et durable, ne constituait pas un abus de majorité.
Il est ainsi exigé des juges du fonds qu’ils recherchent si la décision manifestement contraire à l’intérêt social, n’a pas également pour unique dessein de favoriser les intérêts des actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.
La fraude aux droits du minoritaire
Toutefois, le fait qu’une opération soit conforme à l’intérêt social ne suffit pas à écarter toute responsabilité des actionnaires majoritaires.
Sur le fondement du principe « la fraude corrompt tout », la Cour de Cassation a ainsi établi, dans un arrêt du 30 septembre 2020, que la responsabilité civile des actionnaires majoritaires d’une société anonyme qui votent une augmentation de capital ne peut pas être écartée au simple motif que cette opération aurait été conforme à l’intérêt social de la Social.
La Cour de Cassation reproche en l’espèce à la Cour d’Appel de s’être contentée de débouter la plaignante pour absence de démonstration d’un défaut d’intérêt social de l’opération litigieuse, alors même qu’elle aurait dû rechercher si l’opération, ayant entrainé la sous-évaluation de la Société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses, n’avait pas conduit à priver illégitimement l’associé minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société.
Ainsi, une décision pouvant paraitre comme raisonnable au regard de l’intérêt social, en apurant par exemple le passif, pourra se voir annulée sur le fondement de la fraude si l’opération a pour conséquence d’évincer des minoritaires et ce, alors même que la survie de la société n’est pas remise en cause.
La très grande factualité des décisions rendues en la matière, fondée sur une mise en balance des principes de pérennisation de la société avec ceux de la mise en réserve systématique des dividendes ou de l’impossibilité des actionnaires minoritaires à souscrire à une augmentation de capital, rend difficilement prévisible l’issue des recours.
Dans le cadre de l’intégration de nouveaux investisseurs, il conviendra donc de veiller à l’intérêt des « petits associés ». Si ces derniers s’estiment lésés, ils pourraient en effet tenter de remettre en cause la validité d’une levée de fonds.